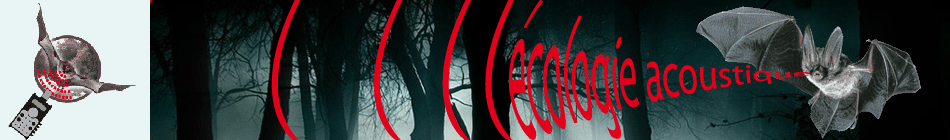Originaire du Limousin, naturaliste depuis l’enfance dans cette région alors préservée du Massif Central de la France, Michel Barataud est passionné de biologie et d’écologie. Investi depuis l’âge de 14 ans dans des associations régionales et nationales, il y mène sans cesse de nombreux travaux d’étude et d’actions pour la protection de la nature et la transmission d’informations. Si l’ornithologie et l’entomologie ont précédé son intérêt pour la mammalogie, depuis 1985 les chauves-souris concentrent la majeure partie de ses activités scientifiques.
Son programme de recherches sur le sonar, entamé en 1988, repose sur des dizaines de milliers d’heures de terrain et d’analyses, et la collaboration avec de nombreux collègues (dont Jean Roché, Yves Tupinier, Sébastien Roué, Jean-François Desmet, Marc Van de Sijpe, etc.), notamment au sein de la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) qui compte un Groupe Chiroptères très actif. Il a publié, outre de nombreux articles, une première synthèse de ses recherches sur l’identification acoustique en 1996 (« Ballades dans l’inaudible », éditions SITTELLE).
En février 2012, les éditions associées de BIOTOPE et du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris ont publié un ouvrage complet (livre + DVD) rassemblant la synthèse de ses travaux en acoustique sur l’identification et l’écologie des espèces, dont l’originalité est qu’ils associent l’analyse auditive à l’analyse informatique, et qu’ils intègrent pleinement l’étude comportementale des individus.
Une méthode naturaliste à part entière, qui est enseignée en France et en Europe dans le cadre de formations à destination de milliers d’amateurs et de professionnels, à raison de plus d’une centaine de sessions depuis 1995.
Entre 2006 et 2015, Michel Barataud a débordé de l’Europe en étudiant le sonar et l’écologie des chiroptères des Antilles françaises, de la Guyane, des Mascareignes et des Comores.
En 2017 il a créé avec quelques collègues et amis une revue naturaliste gratuite, PLUME DE NATURALISTES, basée sur le principe fondamental de liberté de diffusion de la connaissance par ceux qui la produise, sans intermédiaire qui se pose en juge et censeur.
 Sa conviction initiale est restée inchangée : la survie et la diffusion de la méthode acoustique naturaliste doivent devenir le plus vite possible indépendantes de son concepteur, dont la volonté est de la voir sans cesse évoluer grâce aux contributions coordonnées de ses nombreux utilisateurs présents et à venir.
Sa conviction initiale est restée inchangée : la survie et la diffusion de la méthode acoustique naturaliste doivent devenir le plus vite possible indépendantes de son concepteur, dont la volonté est de la voir sans cesse évoluer grâce aux contributions coordonnées de ses nombreux utilisateurs présents et à venir.
Michel Barataud avec Sylvie Giosa, collaboratrice du programme depuis 2006 (photo J.F. Desmet ; 2010).
Mot de l’auteur :
Mon parcours de recherche scientifique ressemble à ma vision de la nature : sauvage et relié. Sauvage car, bien que suivant les règles fondamentales de la science, il se situe à l’écart du sérail universitaire ; relié car il est en réseau avec de nombreux collègues et surtout en prise directe avec la réalité perceptible sur le terrain.
Mes recherches sur l’identification acoustique des chiroptères, initiées en 1988 en Europe puis sous d’autres latitudes, se sont ainsi toujours inscrites dans un processus naturaliste, avec l’utilisation de la technologie en tant qu’outil transitoire, et l’utilisation des sens et de la pensée en amont et en aval du détecteur d’ultrasons. C’est cette démarche qui a permis, après une longue phase de collecte de données sonores de référence sur des individus en vol libre sur leurs terrains de chasse (grâce à un marquage luminescent permettant de les suivre visuellement), de mettre en évidence des critères croisés entre la variabilité des émissions sonar (fréquences, durée, rythmique) de chaque espèce, et le comportement précis de l’individu au moment de l’émission.
L’application de cette méthode qualifiée d’écologie acoustique, établissant un lien dynamique entre des valeurs chiffrées et des données comportementales, présente plusieurs vertus :
- elle optimise radicalement la robustesse de l’identification d’une espèce (car la variabilité des émissions sonar est toujours en lien avec les contraintes de l’environnement de vol et une intention de l’individu, éléments désormais mieux prédictibles grâce à cette méthode) ;
- elle redonne à l’observateur une liberté d’utilisation de ses sens et de sa réflexion (au lieu de tout déléguer à des algorithmes), et lui confère un savoir intégré : deux conditions essentielles de la jouissance d’être au monde ;
- sur un plan plus fondamental, grâce à cette possibilité de « se glisser dans la peau de l’animal observé », elle défend un exercice de la science reconnecté avec le terrain, et redonne toute sa noblesse au mot « naturaliste », revendiqué par Linné, Humboldt, Daubenton, Lamarck, Darwin, Hainard… et menacé de nos jours d’une tentative de dévoiement par des philosophes et des anthropologues.
Les outils technologiques actuels permettent de dépasser les limites de la simple observation sensorielle, impuissante dans le domaine des ultrasons. Mais juste derrière cette phase de collecte de données auparavant inaccessibles, la perception du monde grâce à nos sens et à notre pensée analytique doit rester prioritaire. Par son aptitude à interpréter le contexte dynamique de comportements naturels complexes, cette méthodologie reste plus objective qu’un programme informatique emprisonné dans des lignes de codes (par ailleurs elles-mêmes imprégnées de la subjectivité humaine), dont la qualité de répétabilité fidèle est à double tranchant puisqu’elle entraîne une perte d’adaptabilité face à la richesse mouvante de ces phénomènes comportementaux.
Cette méthode s’adresse à tous ; mais elle sera comprise plus vite et mieux par les personnes qui ne confondent pas la science avec la technique, autrement dit la pensée avec l’outil. Les deux sont complémentaires mais chacun doit garder sa place.
La chance de la transmission
Les deux fils de Michel Barataud ont hérité de sa passion naturaliste. Pierre Barataud, photographe de nature, exerce ses talents en Ariège. Julien Barataud est auteur d’un programme de recherche indépendant sur l’acoustique comme son père, mais dédié aux Orthoptères Ensifères (Sauterelles, Grillons, Courtilières) ; son ouvrage est paru en 2025 aux éditions Biotope.

Michel et Julien en 2015 ; photo Pierre Barataud