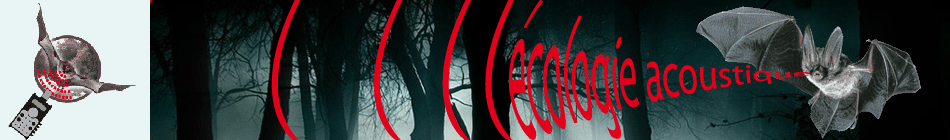Originaire du Limousin, naturaliste depuis l’enfance dans cette région alors préservée du Massif Central de la France, Michel Barataud is a biology and ecology enthusiast. From the age of 14 he has been involved in a number of regional and national naturalist's associations, and continues with unabated enterprise to pursue his research while at the same time leading initiatives in Nature conservation and the popularization of science. His main interest was at first in birds and insects before it turned to mammals and especially bats, which are since 1985 the main focus of his research activities.
His research programme on the bat sonar, initiated in 1988, involved thousands of hours of fieldwork and analyses, et la collaboration avec de nombreux collègues (dont Jean Roché, Yves Tupinier, Sébastien Roué, Jean-François Desmet, Marc Van de Sijpe, sites, etc.), in particular from the very active 'bat' group of SFEPM (French Society for the Study and Protection of Mammals) in which several hundred bat workers share their experience. Alongside numerous scientific papers, studies reports, he published a first summary of his research on the acoustic identification of bat species in 1996 (« The Inaudible World », SITTELLE Editions).
In February 2012, the publishing departments of Biotope and the French Museum of Natural History joined forces to publish a more ambitious work (book + DVD) recapitulating all his findings on the acoustics of bat identification and ecology, The particularity of the method described is that it associates auditory analysis and computer-based acoustic analysis, while taking behavioural factors fully into account.
This naturalist's approach, qui est enseignée en France et en Europe dans le cadre de formations à destination de milliers d’amateurs et de professionnels, à raison de plus d’une centaine de sessions depuis 1995.
Entre 2006 and 2015, Michel Barataud's curiosity has led him beyond the borders of Europe to study the sonar and ecology of the bats of the French Antilles, de la Guyane, des Mascareignes et des Comores.
In 2017 together with colleagues, he set up a free naturalist magazine, PLUME DE NATURALISTES, based on the fundamental principle of the free dissemination of knowledge by those who produce it, without intermediaries acting as judges and censors.
 Michel Barataud's firm opinion is : that his naturalist's acoustic method must quickly leave the orbit of its original designer and become the public property of naturalists worldwide, His wish is that the method keeps on developing with continual coordinated input from its many current and future users.
Michel Barataud's firm opinion is : that his naturalist's acoustic method must quickly leave the orbit of its original designer and become the public property of naturalists worldwide, His wish is that the method keeps on developing with continual coordinated input from its many current and future users.
Michel Barataud with Sylvie Giosa, a collaborator to the programme since 2006 (photograph by J.F. Desmet ; 2010).
Mot de l’auteur :
Mon parcours de recherche scientifique ressemble à ma vision de la nature : sauvage et relié. Sauvage car, bien que suivant les règles fondamentales de la science, il se situe à l’écart du sérail universitaire ; relié car il est en réseau avec de nombreux collègues et surtout en prise directe avec la réalité perceptible sur le terrain.
Mes recherches sur l’identification acoustique des chiroptères, initiées en 1988 en Europe puis sous d’autres latitudes, se sont ainsi toujours inscrites dans un processus naturaliste, avec l’utilisation de la technologie en tant qu’outil transitoire, et l’utilisation des sens et de la pensée en amont et en aval du détecteur d’ultrasons. C’est cette démarche qui a permis, après une longue phase de collecte de données sonores de référence sur des individus en vol libre sur leurs terrains de chasse (grâce à un marquage luminescent permettant de les suivre visuellement), de mettre en évidence des critères croisés entre la variabilité des émissions sonar (fréquences, durée, rythmique) de chaque espèce, et le comportement précis de l’individu au moment de l’émission.
L’application de cette méthode qualifiée d’écologie acoustique, établissant un lien dynamique entre des valeurs chiffrées et des données comportementales, présente plusieurs vertus :
- elle optimise radicalement la robustesse de l’identification d’une espèce (car la variabilité des émissions sonar est toujours en lien avec les contraintes de l’environnement de vol et une intention de l’individu, éléments désormais mieux prédictibles grâce à cette méthode) ;
- elle redonne à l’observateur une liberté d’utilisation de ses sens et de sa réflexion (au lieu de tout déléguer à des algorithmes), et lui confère un savoir intégré : deux conditions essentielles de la jouissance d’être au monde ;
- sur un plan plus fondamental, grâce à cette possibilité de « se glisser dans la peau de l’animal observé », elle défend un exercice de la science reconnecté avec le terrain, et redonne toute sa noblesse au mot « naturaliste », revendiqué par Linné, Humboldt, Daubenton, Lamarck, Darwin, Hainard… et menacé de nos jours d’une tentative de dévoiement par des philosophes et des anthropologues.
Les outils technologiques actuels permettent de dépasser les limites de la simple observation sensorielle, impuissante dans le domaine des ultrasons. Mais juste derrière cette phase de collecte de données auparavant inaccessibles, la perception du monde grâce à nos sens et à notre pensée analytique doit rester prioritaire. Par son aptitude à interpréter le contexte dynamique de comportements naturels complexes, cette méthodologie reste plus objective qu’un programme informatique emprisonné dans des lignes de codes (par ailleurs elles-mêmes imprégnées de la subjectivité humaine), dont la qualité de répétabilité fidèle est à double tranchant puisqu’elle entraîne une perte d’adaptabilité face à la richesse mouvante de ces phénomènes comportementaux.
Cette méthode s’adresse à tous ; mais elle sera comprise plus vite et mieux par les personnes qui ne confondent pas la science avec la technique, autrement dit la pensée avec l’outil. Les deux sont complémentaires mais chacun doit garder sa place.
La chance de la transmission
Les deux fils de Michel Barataud ont hérité de sa passion naturaliste. Pierre Barataud, photographe de nature, exerce ses talents en Ariège. Julien Barataud est auteur d’un programme de recherche indépendant sur l’acoustique comme son père, mais dédié aux Orthoptères Ensifères (Sauterelles, Grillons, Courtilières) ; son ouvrage est paru en 2025 aux éditions Biotope.

Michel et Julien en 2015 ; photo Pierre Barataud